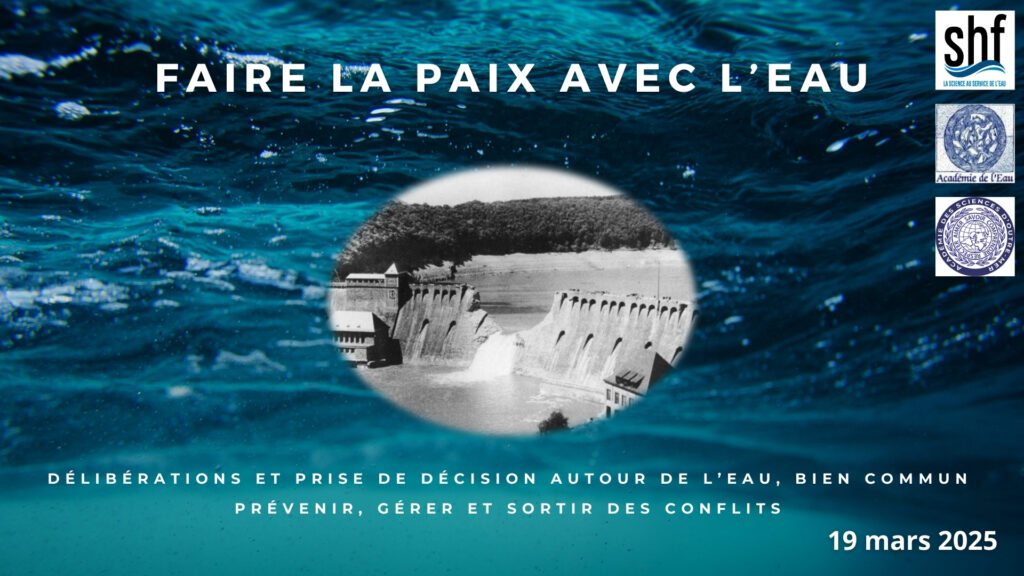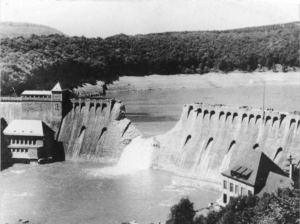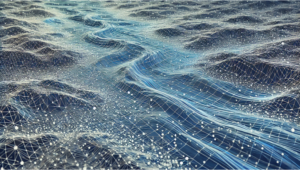Le séminaire « Faire la paix avec l’eau – délibérations et prise de décision autour de l’eau, bien commun – prévenir, gérer et sortir des conflits », s’est tenu à Paris, à l’Académie des Sciences d’Outre Mer, le 19 mars 2025.
Ce séminaire fait partie d’un cycle de rencontres organisées par le réseau « les sciences humaines et sociales pour les enjeux de l’eau », porté conjointement par la Société Hydrotechnique de France et l’Académie de l’Eau. Ce réseau met en évidence les questions humaines, historiques et sociales sous-jacentes aux problématiques de l’eau, et tisse des liens entre les communautés des sciences humaines et sociales et celles de l’hydraulique et de l’hydrologie.
Les leçons des précédentes éditions de cette série.
Le réseau a déjà organisé les séminaires suivants :
– « Le futur de l’eau dans la transition écologique », 21 juin 2023
– « Droits et eau », 5 avril 2022
– « Savoirs et expertises dans les débats sur les questions hydrauliques, les projets et leur mise en œuvre » (2021)
– « Comment les tensions sur l’eau conduisent-elles à en repenser la gouvernance ? « (2019)
– « Sciences humaines et sociales et Enjeux de l’eau – Aménagements hydrauliques et énergétiques en France : comment construire des consensus ? » (2018)
De ces précédents séminaires, plusieurs conclusions avaient pu déjà être établies :
- Les tensions croissantes sur l’eau, qu’il s’agisse d’un excès ou d’un manque d’eau, posent de nombreux problèmes de gouvernance, notamment en raison de la multitude d’acteurs concernés, et de l’empilement des textes juridiques pour un type d’ouvrage ou de situation donné. Il est souhaitable à chaque fois que c’est possible de travailler à l’échelle appropriée (celle des bassins hydriques), en tenant compte des données de terrain. Il faut souligner l’importance des approches historiques, car mettre en perspective une situation ou un problème sur le temps long donne du sens aux transformations, permet à un large éventail d’acteurs de relativiser et de s’approprier les problématiques. Le coût des transformations est à prendre en compte (réduire la consommation agricole en eau ne se fait pas sans perte de revenu pour les agriculteurs). Enfin, il faut garder à l’esprit que ce sont presque toujours les plus pauvres qui sont les plus exposés aux crises de l’eau, et qui en souffrent le plus.
- Les savoirs sont un élément essentiel dans la mesure où ils sont censés apporter des faits et des analyses objectives. Mais aujourd’hui les dires des experts sont de plus en plus remis en question, d’où l’importance de la pluralité des experts et des coopérations entre disciplines, ainsi qu’entre zones géographiques, surtout pour les questions transfrontalières. Il faut travailler à renforcer la crédibilité et la légitimité des experts, qui sont les acteurs les mieux placés pour mettre du « rationnel » dans les débats. Sachant que communiquer vers le public ne fait pas partie du bagage culturel et des savoirs des ingénieurs.
- L’eau est un bien commun, il est donc essentiel de savoir comment re-questionner les droits acquis sur l’eau en « apaisant » les discussions. La société civile et les parties prenantes sont incontournables dans toutes les questions de gouvernance et d’aménagements
Le séminaire « Faire la paix avec l’eau ».
Ce nouveau séminaire visait prioritairement à identifier les pistes et pratiques favorables à la résolution pacifique – ce qui ne veut pas dire sans tensions – des conflits liés à l’eau. Il visait à intégrer également les problématiques de sortie de crise lorsque les conflits graves n’ont pu être prévenus. Dans l’un ou l’autre cas, il s’agissait d’éclairer les conséquences au niveau des territoires. A côté des espaces de conflits ou de mitigation, le séminaire entendait également mettre en lumière les vertus sociales, culturelles et environnementales de l’eau pourvoyeuses d’aménités capables de renouveler les liens entre individus, entre communautés à l’échelle d’un territoire.
Il a rassemblé 13 communications, sélectionnées par le comité de pilotage à l’issue de l’appel à communications qui avait été lancé en juin 2024. Ce panel de présentations a couvert de nombreuses régions, en France (Gascogne, Normandie), mais aussi en Suisse, en Afrique, au Proche Orient etc. Des questions relatives à des fleuves transfrontaliers (Rhône, Logone) ont été évoquées. Ces communications ont été réparties en quatre sessions, présidées respectivement par Mathieu Brugidou (EDF R&D), Marc-Antoine Martin (Académie de l’Eau), Monica Cardillo (Université de Nantes), et Denis Cœur (ACTHYS). Chacune des quatre sessions a été accompagnée d’une séance de discussions.
Le séminaire a été conclu par une table ronde, modérée par Pierre-Louis Viollet (SHF), à laquelle ont participé Abou Amani (dr., UNESCO, directeur de la Division des Sciences de l’Eau), Fadi Georges Comair (dr., Académie des sciences d’Outre Mer), Eric Gaume (prof., président de la division Hydrologie et ressources en eau de la SHF, Univ. Gustave Eiffel), Alain Lamballe (Général, Directeur de recherche au Centre Français de Recherche sur le Renseignement), et Pascale Lyaudet (ing., EDF Hydro Alpes, Directrice adjointe).
Les éléments conclusifs de ce séminaire sont en cours d’élaboration. Ils confirment déjà certains points, comme les difficultés à présenter au public les études scientifiques (par exemple, montrer que l’incertitude affichée sur certains résultats est un gage de l’intégrité de l’étude), et les difficultés à faire cohabiter les désirs régionaux de développement immobilier et de développement économique (y compris agricole) avec les réalités des tensions sur l’eau. Certaines régions ont développé au fil des décennies une « culture » de compromis ou de partage de l’eau ce qui favorise le développement de visions communes, et de dialogues entre les parties. Dans d’autres, au contraire, les tensions sont extrêmes, avec des acteurs ou des victimes potentiellement violents, ce qui est favorisé lorsque les Etats sont potentiellement instables, absents ou très répressifs. Il faudrait pouvoir lever les « tabous » autour de certaines questions, et les analyser hors présupposés culturels, idéologiques ou religieux, à partir d’analyses régionales. Entre Pays riverains d’une même ressource, l’Eau peut être source de coopération lorsque des protocoles ou des chartes peuvent être signés. A l’opposé, l’Eau est dans certaines régions cause de guerres, ou même moyen de faire la guerre.
Le Comité de pilotage était constitué des personnalités suivantes : Monica Cardillo (Académie de l’Eau), Denis Cœur (ACTHYS), Philippe Gourbesville (Univ. Nice), Arthur Jobert et Mathieu Brugidou (EDF R&D), Ahmed Khaladi (CNR), Evelyne Lyons (Académie de l’Eau), Marc-Antoine Martin (Académie de l’Eau), Virginie Orfila (SHF), Pierre-Louis Viollet (SHF, président)
L’Académie des Sciences d’Outre Mer a apporté un soutien très apprécié à l’organisation du séminaire, et les membres de cette Académie ont contribué de façon importante aux discussions.
La vidéo complète de la table ronde est consultable sur la chaîne YT de la SHF 👉 https://www.youtube.com/watch?v=hwlPUx91_EQ&t=576s
Les conclusions de ce séminaire, en cours de rédaction, pourront être consulté sur les sites de la SHF et de l’Académie de l’Eau.
Pierre-Louis Viollet
SHF, animateur du Comité de pilotage du colloque